« Il sortait de la pensée paresseuse ou binaire »
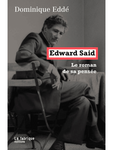
Dans « Edward Said, le roman de sa pensée », l’écrivaine rend hommage à l’intellectuel inspiré par les Lumières, féru de littérature et de musique, militant de la cause palestinienne, sans pour autant exonérer le monde arabe de ses responsabilités.
 La romancière Dominique Eddé a participé, pour les éditions du Seuil, au lancement en France de l’Orientalisme d’Edward W. Said, en 1980. Puis elle a traduit plusieurs ouvrages de l’écrivain, dont elle fut très proche. Dans Edward Said, le roman de sa pensée, qui vient de paraître à La Fabrique, l’écrivaine franco-libanaise dresse un portrait intellectuel et intime du penseur palestino-américain. Elle et lui partageaient des « signaux de reconnaissance » : leur amour de la littérature et de la musique, leur combat pour les droits des Palestiniens… « Accolés à des noms arabes, Said et Eddé, nos prénoms, à eux seuls, prédestinaient notre rencontre, écrit-elle. Lui, l’anti-impérialiste, était flanqué du roi d’Angleterre, et moi, l’anticléricale, d’un saint associé à l’Inquisition. » Elle revient sur les combats d’un orateur charismatique, héritier d’une sorte d’universel, passionné de littérature, de philologie et de musique.
La romancière Dominique Eddé a participé, pour les éditions du Seuil, au lancement en France de l’Orientalisme d’Edward W. Said, en 1980. Puis elle a traduit plusieurs ouvrages de l’écrivain, dont elle fut très proche. Dans Edward Said, le roman de sa pensée, qui vient de paraître à La Fabrique, l’écrivaine franco-libanaise dresse un portrait intellectuel et intime du penseur palestino-américain. Elle et lui partageaient des « signaux de reconnaissance » : leur amour de la littérature et de la musique, leur combat pour les droits des Palestiniens… « Accolés à des noms arabes, Said et Eddé, nos prénoms, à eux seuls, prédestinaient notre rencontre, écrit-elle. Lui, l’anti-impérialiste, était flanqué du roi d’Angleterre, et moi, l’anticléricale, d’un saint associé à l’Inquisition. » Elle revient sur les combats d’un orateur charismatique, héritier d’une sorte d’universel, passionné de littérature, de philologie et de musique.
 Photo : Une affiche d’Edward Said sur un mur de Ramallah, en 2004. Photo Justin McIntosh
Photo : Une affiche d’Edward Said sur un mur de Ramallah, en 2004. Photo Justin McIntosh
Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Edward W. Said ?
Notre première rencontre remonte à 1979, alors que je travaillais pour les éditions du Seuil. Quand nous nous sommes retrouvés dans les années 90, les circonstances étaient étranges car marquées par la maladie qui changeait notre rapport au temps. Je sortais d’une chimiothérapie éprouvante, il découvrait qu’il avait une leucémie très sévère, contre laquelle il s’est battu pendant douze ans. Toutes les questions s’imposaient dans l’urgence. Cela rendait la relation très vivante, très intense. C’était aussi une relation tragique : il y avait de l’impossible dans l’air. La proximité de la mort nous empêchait de nous projeter dans l’avenir.
Pourquoi ce livre aujourd’hui ?
Il m’a semblé que le temps avait mûri, [Said est mort en 2003, ndlr] qu’en termes d’écriture, le moment était venu de trouver le ton juste. D’aborder tous les temps comme dans une partition musicale : en essayant de jouer de plusieurs instruments à la fois. Je voulais me servir, sans clivage, de ce que j’avais lu, ressenti, analysé ou vécu avec et sans lui. Je voulais écrire aussi sur un sujet qui nous a taraudés et épuisés l’un comme l’autre toutes ces années : la question palestinienne. Et évoquer la musique, qui tenait un rôle important dans notre relation. Tout cela constituait un large éventail de « lieux » de retrouvailles.
Le lancement du livre « l’Orientalisme » en 1980, reconnu comme un ouvrage de référence dans le monde anglo-saxon, a été difficile en France…
J’ai eu, à l’époque, beaucoup de mal à mobiliser les médias français. Surtout la télévision. Je mesure, en publiant ce livre, à quel point Edward W. Said est encore peu connu en France. C’est un paradoxe : grand critique littéraire, Said a été un « passeur » de la littérature française aux Etats-Unis. On aurait pu supposer qu’il ne rencontrerait aucune difficulté à se faire connaître ici.
Pour la première fois avec l’Orientalisme, qui allait être traduit dans une trentaine de langues et devenir une œuvre fondamentale, quelqu’un montrait, de manière méthodique, que le savoir occidental sur l’Orient se fondait largement sur un imaginaire qui inventait l’autre, sinon l’ignorait ou même le niait. C’était historique : un intellectuel de grande envergure venait donner de la visibilité et de la voix à ceux qui ne se sentaient ni reconnus ni entendus, disait en somme que l’Occident ne pouvait continuer à écrire seul l’histoire.
Comment expliquer ce désintérêt ?
Avec l’Orientalisme, Said mettait en cause deux siècles de savoir accumulé. Il relisait d’un œil critique des chefs-d’œuvre de la littérature occidentale qu’il admirait pourtant profondément, mais, pour lui, l’admiration n’empêchait pas la clairvoyance. Rien que ce vers de Lui, un poème de Victor Hugo à la gloire de Napoléon : « Sublime, il apparut aux tribus éblouies / Comme un Mahomet d’Occident. » C’est un exemple parmi tant d’autres d’une vision de « l’Arabe » en tout contraire à son propre imaginaire. C’est pour cela que Said était crucial : il soulignait, avec un vocabulaire et un appareil critique occidental, ce qui ne fonctionnait pas dans la manière des Occidentaux de voir l’Autre, ce qui déformait leur regard. Par ailleurs, l’Orientalisme est arrivé en France au moment où les Nouveaux Philosophes faisaient une relecture de l’histoire et du rapport de l’Occident au tiers-monde. Ils voulaient remettre en cause une certaine culpabilité de l’Europe [le Sanglot de l’homme blanc de Pascal Bruckner sera édité au Seuil en 1983, ndlr].
Pour le milieu intellectuel et médiatique français, Said était une voix inclassable et trop nuancée pour s’intégrer dans le débat du « pour ou contre ». Il sortait de la pensée paresseuse ou binaire. Peut-être qu’aujourd’hui encore, Said est trop exigeant pour être audible entre Eric Zemmour et Tariq Ramadan…
Selon vous, Edward W. Said ne tient pas tout entier dans ses livres. Vous dites qu’il a inventé un style. Quel serait le « style Said » ?
Il a réussi à décloisonner les disciplines alors qu’il venait lui-même d’un milieu très académique. Enseignant la littérature comparée, il aurait pu se contenter de comparer Conrad à Melville ou à Swift, mais il a très vite laissé son histoire personnelle infiltrer son parcours intellectuel. En 1967, la guerre des Six Jours a bouleversé la vision qu’il avait de son rôle. Il a assumé de parler d’une place qui était subjective. A la fois palestinien, américain et même égyptien, il était aussi polyglotte puisqu’il lisait aussi bien le français que l’arabe ou l’anglais. Il était à la fois passionné de philologie et de musique. Il était l’héritier d’une sorte d’universel, très lié à l’esprit des Lumières. Il a parfois stupéfié son auditoire. Il pouvait commencer une conférence sur la Palestine avec force précisions sur les dates, le nom des terres confisquées… et poursuivre sans rupture sur Giuseppe Tomasi Di Lampedusa, Beethoven ou Césaire. Il citait très souvent une phrase d’Adorno sur l’exil : « It’s part of morality not to feel at home in one’s home », (« c’est une partie de la morale de ne pas se sentir chez soi chez soi »).
Il a défendu jalousement et brillamment cet endroit de l’exil d’où l’on peut regarder partout. Cela a certainement contribué à son charisme. Il était un brillant orateur. Quel que soit le lieu du monde où il parlait, jamais personne n’était largué, il n’apportait pas un savoir local ou étranger, mais un savoir constamment irrigué par différentes cultures. C’était cela son style. On peut même parler d’une « coquetterie »…
Un dandysme ?
Il avait une exigence esthétique qu’on retrouve dans sa passion pour la musique. Il avait un plaisir physique de la prise de parole, tout en étant habité par l’angoisse de mal faire, d’être à côté de la plaque, ou comme il disait : « Not quite right. » Il pouvait être affirmatif mais jamais dans une affirmation imperméable au doute. Et ce doute, il n’avait pas à le chercher très loin, il était en lui.
Selon vous, la fugue est le style musical qui le définirait le mieux. Pourquoi ?
D’abord, parce qu’il était toujours en partance. La fugue n’est pas une écriture musicale de la métaphore ou de l’enflure. C’est un style qui va très vite, qui ne se laisse pas distraire. Said avait choisi une écriture sans métaphore, car c’était un homme pressé, etsous pression. Il se sentait une responsabilité permanente, il était toujours dans un provisoire. Son style parfois en souffrait, notamment dans ses textes pour la presse, des écrits très rapides, faits pour convaincre. En musique, la fugue reconduit un même motif de diverses façons, à plusieurs voix. Et, c’est chaque fois dans ce petit changement, dans cette répétition positive, que s’installe la magie. Cette répétition positive est l’exact opposé de la répétition négative de l’histoire du conflit israélo-palestinien. Ce conflit est une sorte d’antifugue où la répétition reconduit le même en pire.
Edward W. Said n’a pas fondé une école, mais il a contaminé nombre de chercheurs après lui, irriguant les post-colonial studies, les subaltern studies…
Oui. J’écris le mot « post-colonial » au tout début de mon livre, pour ne plus avoir à le prononcer ensuite. Je me méfie un peu des concepts qui tranchent catégoriquement dans le temps. Edward est décédé en 2003, l’année de la seconde guerre du Golfe. Dans la lignée de Foucault, Arendt ou Auerbach, il appartient en un sens à une famille d’humanistes en voie de disparition. D’où le titre du Haaretz à son sujet : « Le dernier intellectuel juif ». Les intellectuels publics aujourd’hui sont pour la plupart des experts ou des partisans qui défendent des opinions plutôt que la pensée. Défendre la pensée, c’est autre chose, c’est prendre des risques, c’est être sur plusieurs fronts à la fois, c’est accepter de n’être ni avec l’un ni avec l’autre. Et cela, Said l’a fait jusqu’à se retrouver parfois dans une solitude rare. Il a défendu l’amateur contre le professionnel. L’amateur étant celui qui va un peu partout avant d’affirmer, avant de décider. Cette forme d’éclectisme et de polyvalence se perd.
Vous dites que le débat public actuel met face à face deux sortes d’orientalismes ?
D’un côté, tous ceux qui renvoient les musulmans à l’identité d’un islam intangible et figé, comme Alain Finkielkraut ou Manuel Valls. Ceux-là ont tendance à ne pas savoir entendre des mémoires qui ne sont pas les leurs. La culture arabo-islamique est plus souvent perçue par eux comme une erreur à réparer qu’une différence à respecter. Si bien que trop de Français musulmans se sentent simultanément montrés du doigt ou pris en otages. Dans un pays comme le Liban, où je suis née, 500 000 réfugiés palestiniens ont débarqué avec la clé de leur maison et rien d’autre. Peut-on demander à la génération qui hérite de cette mémoire de n’avoir en tête que l’héritage occidental ?
De l’autre côté, il y a des militants tels que les indigènes de la République ou d’une gauche paternaliste qui pensent bien faire en baissant le niveau d’exigence dès lors qu’on parle de l’islam. Bien sûr que le colonialisme a été un traumatisme dont on paie encore le prix. Bien sûr qu’il ne faut pas faire l’impasse sur cette partie de l’histoire. Mais penser l’histoire des Arabes, dont je suis, comme étant la résultante de ce seul traumatisme, les exonérer de leur propre responsabilité, de leur incapacité à gérer le pluralisme et l’altérité, passer à la trappe les pages noires de leur passé et de leur présent, c’est une défaite intellectuelle sans nom, c’est humiliant.
Cette écriture victimaire de l’histoire est aussi dangereuse que déprimante. Said, lui, dénonçait l’impérialisme mais aussi les défaillances de la pensée critique arabe. La politique israélienne, mais aussi la corruption de l’Etat palestinien. Il ne cédait rien au principe de l’égalité tout en étant très sévère envers les Arabes ignorants de l’histoire de l’antisémitisme.
Edward W. Said avait-il pressenti le retour du religieux ?
S’il était encore vivant, il aurait sans doute contribué à montrer la responsabilité de l’impérialisme dans le jihadisme actuel. Il n’a peut-être pas mesuré, par ailleurs, l’ampleur du retour du religieux. Ni la menace qui pesait sur le destin des chrétiens arabes. Il répétait qu’il était un « secular intellectual » et il s’est consacré à un combat avant tout politique, intellectuel, culturel. Le religieux, nous l’avons tous laissé trop tranquille.
Votre livre est aussi un livre sur le deuil…
Sur le deuil de l’idéal. Je crois en l’utopie mais je pense l’idéal dangereux car il met l’homme dans une position de toute-puissance. Il crée de la surdité, de la cécité. L’utopie, c’est un élan partagé, le droit de continuer à rêver que les choses se passent autrement. Elle ne repose pas sur la toute-puissance individuelle. L’idéal peut tuer, et même tuer l’amour. Avec Said, nous avons connu quelque chose d’exceptionnel. Un cadeau, parfois très coûteux. Ce n’était pas l’idéal : nous avions trop envie que les choses bougent et l’idéal fige.
Avec ce livre, écrivez-vous, « je regarde l’image d’Edward se libérer »…
L’amour est possessif, et le deuil est une incroyable leçon d’humilité. Puisqu’on est encore en vie, et que l’autre n’est plus là, puisqu’il peut mourir sans vous, il faut reconnaître qu’il peut vivre aussi sans vous. Le deuil, c’est le moment où, comme l’écrivait Mallarmé, « tel qu’en lui-même l’éternité le change », l’être qu’on a tant aimé est rendu à son passé et à sa vie avec toute sa part inatteignable. C’est le contraire d’un mouvement totalitaire de possession. Quand l’autre est mort, il part avec ses vies, et il nous reste simplement à poursuivre la part de celle qu’on a connue de lui.
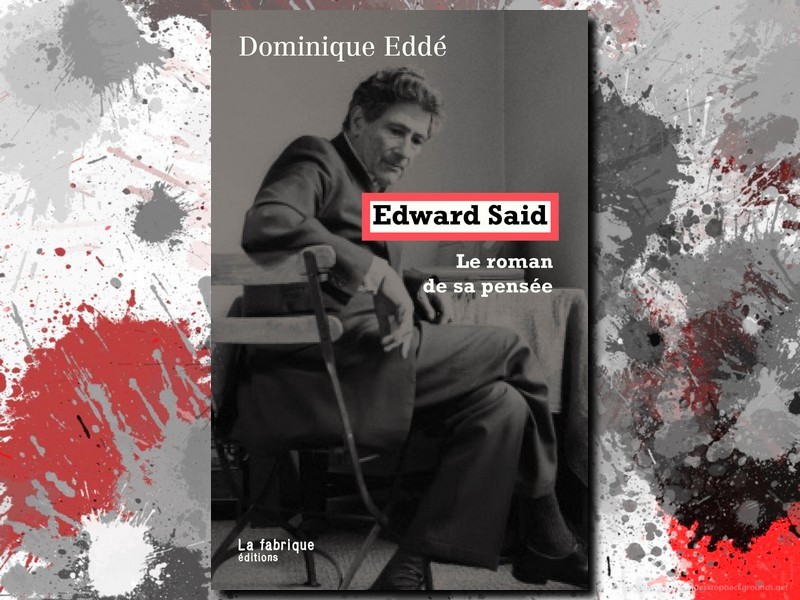
Dominique EDDÉ, Edward Saïd – Le roman de sa pensée, La fabrique, 2017 - 15 euros
sur France Culture - Emission la Grande Table
