Un point sur l’option "deux états", palestinien et israélien, vivant côte à côte

Lors de leur rencontre à Washington, Trump et Netanyahou ont semblé abandonner l’idée de deux États, palestinien et israélien, vivant côte à côte. Qu’est-ce que cela implique ? Entretien avec l’historien Vincent Lemire.
Cet entretien a été publié début janvier 2017 sur Mediapart. Nous choisissons de le présenter de nouveau, dans une version un peu raccourcie, dans la foulée des déclarations de Donald Trump et Benjamin Netanyahou qui semblent enterrer la « solution à deux États » longtemps privilégiée par la communauté internationale afin de résoudre le conflit israélo-palestinien.
La « solution » à un ou deux États partage-t-elle de manière claire le champ politique israélien ?
Il faut souligner que l’option binationale n’est pas une idée récente ; ce qui a changé, c’est la couleur politique de ses porte-voix, et donc la définition même de cette option. En gros, ce qui était une idée « de gauche » et fondamentalement palestinienne est en train de devenir une idée portée par l’extrême droite israélienne. L’option binationale est très ancienne et elle s’est forgée au sein de nombreux foyers idéologiques, du côté palestinien comme du côté israélien. Il faut rappeler que jusqu’en 1974, et même jusqu’en 1988 dans la Charte de l’OLP, l’option binationale est l’option palestinienne défendue officiellement par l’OLP, et de façon encore plus surprenante c’est l’option qui demeure aujourd’hui la position officielle du Hamas, qui refuse les amendements introduits dans les années 1980 par l’OLP. Dans cette optique, l’État de Palestine irait de la Méditerranée au Jourdain et serait un État laïque et démocratique, où les différentes communautés pourraient coexister pacifiquement.
À l’origine, cette vision palestinienne était donc une déclinaison du droit du sol, une citoyenneté ouverte à vocation universaliste, qui insistait sur le fait qu’il ne pouvait exister sur ce territoire singulièrement mixte un État-nation homogène, mais seulement un État laïque et hétérogène. C’est d’ailleurs ce qui explique en grande partie l’attraction qu’a eue la cause palestinienne sur les extrêmes gauches occidentales. Le FPLP (Front populaire de Libération de la Palestine, tendance marxiste-léniniste de l’OLP) a été particulièrement engagé dans la défense de ce modèle binational. Finalement, c’est seulement le processus d’Oslo, au début des années 1990, qui a réactivé du côté palestinien la solution à deux États, l’un juif et l’autre arabe, solution prônée par l’ONU depuis le plan de partage de novembre 1947.
Côté israélien, le motif d’un État binational est également très ancien, porté notamment par Martin Buber et Judah Magnès au sein du Brit Shalom (« l’alliance pour la paix ») dans les années 1920. Ce sont alors des voix minoritaires, mais qui portent fortement au sein du mouvement sioniste. Cette vision est ensuite reprise par les sionistes marxistes du parti Mapam, sur une base ouvriériste, et on en retrouve encore quelques traces dans ce qu’est aujourd’hui le parti Meretz.
Plus près de nous, Edward Saïd s’était positionné explicitement pour l’option binationale. Encore plus récemment l’écrivain et intellectuel Avraham Yehoshua, clairement positionné à gauche, a publié une tribune en octobre 2015 en expliquant qu’il était depuis 1967 pour une solution à deux États, mais que ce n’était plus envisageable. D’abord parce qu’il a fallu mobiliser 50 000 militaires pour évacuer moins de 8 000 colons à Gaza, à une époque où l’armée israélienne était nettement moins religieuse qu’aujourd’hui, ce qui rend techniquement impossible l’évacuation de 500 000 ou 600 000 colons de Cisjordanie. Le journaliste et écrivain très marqué à gauche Gideon Levy a également changé d’avis et milite désormais pour un État binational, laïque, avec une stricte égalité des droits entre Juifs et Arabes.
Le retour de cette option binationale crée-t-elle aujourd’hui une situation nouvelle ?
Ce qui est nouveau, c’est que l’idée est reprise et captée par de plus en plus de sionistes religieux, qui ne sont plus du tout marginaux, puisqu’ils sont menés par des ministres de premier plan, comme Naftali Bennett, aujourd’hui ministre de l’éducation nationale dans le gouvernement Netanyahou. Que des membres puissants d’un gouvernement israélien explicitent l’idée que la solution à deux États a échoué et qu’il faut annexer la Cisjordanie, c’est effectivement un tournant historique dans l’histoire d’Israël et du mouvement sioniste.
Ce qui est également nouveau, c’est aussi que le président de l’État d’Israël Reuven Rivlin, qui vient du Likoud, dise qu’il faut créer un État démocratique sur la totalité du territoire, alors que la présidence était occupée avant lui par Shimon Pérès qui était le symbole même d’Oslo et de la solution à deux États. Mais si Rivlin et Bennett affichent tous les deux leur soutien à une solution binationale et s’ils sont tous les deux clairement à droite de l’échiquier politique israélien, ils ne parlent pas de la même chose. L’un est un vrai démocrate, l’autre un authentique colon, religieux, habité par une vision messianique du destin d’Israël. L’État binational est donc aujourd’hui un concept fourre-tout, utilisé de manière très ambiguë dans un moment où toutes les lignes politiques ont explosé.

Kerry a-t-il raison de souligner que l’État binational est en train de devenir une réalité sur le terrain ?
Oui, l’État binational existe aujourd’hui de fait parce que la souveraineté israélienne s’exerce partout dans l’ancienne Palestine mandataire, sauf à Gaza et dans les quelques confettis de la zone A qui s’apparentent à des bantoustans. En réalité, comme le dit Gideon Levy, de la Méditerranée au Jourdain, on a aujourd’hui un seul État souverain, une seule monnaie (le shekel), une seule direction politique, une seule armée, qui contrôle toutes les frontières. Un seul État souverain avec trois régimes politiques distincts : un régime démocratique pour les Juifs ; un régime de discriminations pour les Palestiniens israéliens ; et un régime d’apartheid pour les Palestiniens de Cisjordanie.
Le discours de Kerry pointe précisément cela, en démontrant que la déclaration faite en juin 2009 à l’université de Bar-Ilan par Netanyahou, qui faisait mine d’accepter la solution à deux États, était en réalité un plan de communication externe destinée à la seule communauté internationale, alors qu’en interne le discours était tout à fait différent et que toute la politique de son gouvernement allait à l’encontre de cette option, en soutenant les colons par tous les moyens matériels et idéologiques. Kerry dit aujourd’hui aux Israéliens : l’État binational vers lequel vous allez à toute vitesse ne peut pas être à la fois juif et démocratique, il sera l’un ou l’autre, et donc les fondements mêmes de votre projet national sont en péril.
Comment la question démographique et la question démocratique s’emboîtent-elles aujourd’hui ?
Les deux verrous qui s’opposent à l’option binationale sont effectivement l’horizon démocratique et l’horizon démographique, et ce sont les deux arguments forts que Kerry a opposés aux Israéliens dans son discours du 28 décembre dernier. Car derrière la controverse théorique et rhétorique sur un ou deux États, il y a concrètement la question de qui est aujourd’hui et de qui sera demain majoritaire et minoritaire, à la fois sur le plan démographique et sur le plan juridico-politique. La Cisjordanie compte environ 2,3 millions de Palestiniens et 600 000 colons, dont 200 000 autour de Jérusalem. Avec un taux de fécondité supérieur à 4 enfants par femme, alors que côté israélien on est autour de 3 enfants par femme, la démographie joue pour les Palestiniens, ce qui a de quoi faire paniquer l’opinion publique israélienne.
Face à cette situation démographique, l’option d’un État binational « de droite » est assez pragmatique : c’est l’annexion de la zone C, qui compose 60 % du territoire de la Cisjordanie. Il faut rappeler que le plan de partage de 1947 sur la Palestine mandataire proposait 55 % du territoire pour l’État juif et 45 % pour l’État palestinien, sachant qu’on estimait alors la propriété juive à moins de 15 % du territoire. Après la guerre de 1948-1949, Israël est installé sur 78 % de la Palestine mandataire, dans des frontières internationalement reconnues. Kerry a rappelé exactement ces chiffres en citant Shimon Pérès et en suggérant qu’il valait mieux sécuriser ces 78 % plutôt que de se lancer dans des aventures au-delà de la ligne verte de 1949-1967.
Avec l’annexion de la seule zone C, le territoire israélien occuperait 90 % de la Palestine mandataire. L’intérêt pour la droite israélienne est que la zone C englobe une grande partie des colonies et ne compte « que » 150 000 Palestiniens. Cela ne modifierait donc guère l’équilibre démographique actuel, puisque Israël compte déjà environ 1,5 million de citoyens d’origine palestinienne. Dans la vision de l’extrême droite israélienne, il resterait donc les zones A et B, représentant moins de 10 % du territoire de l’ancienne Palestine mandataire avec plus de 2 millions de Palestiniens enfermés dans ces bantoustans, puisqu’il ne serait pas plus question qu’aujourd’hui de les autoriser à voyager, à s’installer à Tel-Aviv ou à Beer-Sheva, à concourir pour les emplois publics ou à intégrer l’armée. C’est vraiment un retournement historique puisqu’il faut se souvenir que ces zones A, B et C sont à l’origine des concepts cartographiques et juridiques forgés à Oslo et destinés à fixer les trois étapes de la restitution de la Cisjordanie aux Palestiniens !
Mais face à ce « binationalisme de droite », l’argument de Kerry est robuste. Il rappelle aux Israéliens que, s’ils font cela, ils auront un État juif, mais pas démocratique. Ce sera en effet un « État d’apartheid » – il a déjà utilisé le terme publiquement – et un État d’apartheid est destiné à sombrer, comme l’a montré l’exemple sud-africain. À l’inverse, si l’égalité de droits était accordée aux Palestiniens annexés, alors Israël serait bien un État démocratique mais ne serait plus un État juif, parce qu’à l’échéance d’une vingtaine d’années, les Palestiniens seraient majoritaires et pourraient accessoirement décider de se rendre aux urnes.

La démographie est fondamentale parce qu’elle traduit ce qui se passe dans l’intimité des familles et dans la profondeur du « pays réel ». La résistance palestinienne, brisée militairement et politiquement, s’est déplacée sur le plan démographique, à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem. Il faut rappeler qu’à Jérusalem, la population juive a été multipliée par 2,5 depuis 1967, alors que dans le même temps la population palestinienne a été multipliée par 4, et cela sans permis de construire et donc presque sans augmentation du nombre de mètres carrés disponibles. Un indice de fécondité de quatre enfants par femme, alors que le niveau d’éducation et l’encadrement médical est un des plus élevés du monde arabe, constitue une aberration statistique qui ne s’explique que par une démographie de résistance qui pose d’énormes problèmes à Israël sur le long terme.
Finalement, avec les victoires diplomatiques récentes (Unesco, ONU), la démographie est la seule stratégie qui s’est révélée gagnante pour les Palestiniens. Même si l’orthodoxisation de Jérusalem-Ouest et l’augmentation corollaire de l’indice de fécondité côté israélien ralentissent cette tendance, la population palestinienne à Jérusalem est aujourd’hui de presque 40 % alors qu’elle n’était que de 25 % en 1967. Une minorité de 5 % ou 10 %, vous pouvez toujours envisager de la marginaliser efficacement ou de la dissoudre, comme les anciennes populations indiennes autochtones d’Amérique du Nord. Mais pas une minorité de 40 %, surtout si elle continue de s’accroître.
Vous êtes spécialiste de l’histoire de Jérusalem. Le discours de John Kerry d’une part et la possibilité évoquée par Donal Trump d’installer l’ambassade américaine à Jérusalem d’autre part constituent-ils des tournants ?
Oui, sans aucun doute. Dans son paramètre numéro 4, Kerry ne dit rien de neuf en affirmant que Jérusalem doit être « la capitale des deux États », Israël et la Palestine. Mais il le dit de façon plus ferme et surtout il abandonne le paradigme Clinton qui était de fait fondé sur une division de la ville, posant d’infinis problèmes et donc hautement improbable. En passant d’un paradigme de la division à un paradigme du partage, même si les modalités pratiques restent à préciser, Kerry met le doigt sur un point fondamental : alors que Jérusalem est souvent décrite comme le nœud du problème israélo-palestinien, son histoire nous apprend qu’elle est au contraire le lieu – le seul – où pourrait s’inventer le début d’une solution, concrètement, et à brève échéance. Jérusalem n’est pas le nœud du conflit ; les deux points vraiment durs, ce sont les colonies du côté israélien et la question des réfugiés du côté palestinien.
Par ailleurs, il faut arrêter de dire que Donald Trump bluffe sur le transfert de l’ambassade à Jérusalem. La nomination annoncée de David Friedman comme ambassadeur des États-Unis en Israël est déjà très inquiétante : Friedman se situe politiquement à la droite de Netanyahou ! Mais on peut dire aussi, comme l’ont fait certains activistes, qu’il est tout à fait logique que les ambassades américaine ou française s’installent à Jérusalem, mais qu’il en faut deux, une pour Israël et une pour la Palestine, puisque il n’y a pas d’autre option possible que Jérusalem soit la capitale à la fois des Palestiniens et des Israéliens.
Techniquement, cela ne pose pas de problèmes particuliers. Bruxelles est à la fois la capitale d’un État (la Belgique), de deux nations (la Flandre et la Wallonie) et d’une entité supranationale (l’Europe) et cela fonctionne, même si les quartiers ne se ressemblent pas et s’agencent diversement entre eux. Par chance, Jérusalem se trouve encore aujourd’hui sur la frontière entre Israël et la Palestine : on peut y accéder des deux côtés, et cela permet d’en faire la capitale légitime et effectives des Israéliens et des Palestiniens, que ce soit dans le cadre d’une solution à deux États ou à un État avec une structure fédérale. Non seulement Jérusalem n’est pas le principal problème, mais on peut même imaginer que ce soit le premier palier d’une solution future. Il existe d’autres exemples de villes dans le monde qui ont des statuts compliqués avec des souverainetés emboîtées et des impôts levés à plusieurs niveaux. Dans le livre Jérusalem – Histoire d’une ville-monde, nous avons montré que l’histoire de cette ville, sur la longue durée, est fondamentalement supranationale. C’est pour cela que Jérusalem est un lieu possible d’expérimentations et peut-être même de solutions.
 Vincent Lemire est historien, maître de conférences à l’université Paris-Est/Marne-la-Vallée, directeur du projet européen « Open-Jerusalem ». Il vient de publier avec Katell Berthelot, Julien Loiseau et Yann Potin Jérusalem. Histoire d’une ville-monde (Champs-Flammarion).
Vincent Lemire est historien, maître de conférences à l’université Paris-Est/Marne-la-Vallée, directeur du projet européen « Open-Jerusalem ». Il vient de publier avec Katell Berthelot, Julien Loiseau et Yann Potin Jérusalem. Histoire d’une ville-monde (Champs-Flammarion).
source : Médiapart
Un lire à lire et à offrir : "Jérusalem. Histoire d’une ville-monde".
S’affranchir des débats passionnés et idéologiques pour retracer la longue histoire de la ville « trois fois sainte » : tel est le défi relevé par l’ouvrage dirigé par Vincent Lemire aux éditions Flammarion, et paru à l’automne 2016. Et ce défi n’était pas des moindres : Jérusalem, que Julien Gracq qualifiait de « ville épileptique » en 1967, ne se situe-t-elle pas, depuis plus de deux millénaires, au croisement des religions monothéistes et de leurs traditions ? N’est-elle pas au cœur d’imaginaires et de fantasmes identitaires ? Ce lourd héritage ne rend-il pas son histoire d’autant plus difficile à écrire ? « Jérusalem ne s’appartient pas, Jérusalem n’est pas à Jérusalem, Jérusalem est une ville-monde, une ville où le monde entier se donne rendez-vous, périodiquement, pour s’affronter, se confronter, se mesurer » . Partant de ce constat, les auteurs de cet ouvrage ont tenté de contrer les représentations fantasmées de Jérusalem pour en proposer une relecture « à la fois contextualisée et située, diachronique et géographique ».
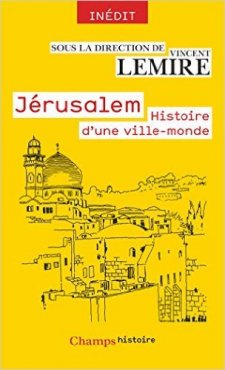
Refaire de Jérusalem un objet d’histoire
Ce vaste programme est inédit dans l’historiographie. Dans son introduction, Vincent Lemire montre que de manière paradoxale, alors que Jérusalem regorge de monuments et de vestiges, elle est une ville « sans histoire », trop souvent « asphyxiée par des mémoires qui court-circuitent et brouillent la chronologie ». Devant la difficulté de passer outre cet héritage mémoriel multiple, jamais une telle synthèse de cette ville n’avait été proposée : cette tentative de faire une « nouvelle histoire de Jérusalem » ne peut donc être que saluée.
D’autant qu’à cette entreprise s’ajoute une autre volonté : celle de faire une histoire incarnée de la ville, en prêtant attention à la topographie, au relief, à la situation, à l’urbanisme et au peuplement. Car, comme le souligne Vincent Lemire, la géographie est l’autre grande absente de l’historiographie de Jérusalem, tant elle est supplantée par les analyses géopolitiques : « l’histoire de Jérusalem est généralement racontée sans que les lieux (rues, monuments, collines, vallées, sources, roches, grottes, murailles, cimetières) soient autre chose qu’une carte d’état-major ou qu’un simple décor à usage folklorique ou patrimonial ».
Pour ce faire, une large panoplie de cartes ainsi qu’une chronologie de référence pour l’histoire de la ville des origines à nos jours sont à trouver au fil du texte et en annexe de ce livre.
Quatre auteurs se sont partagé l’écriture de cette grande synthèse (430 pages de texte) :
![]() Vincent Lemire, directeur de cette publication, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée. Ses recherches portent sur Jérusalem et le Proche-Orient contemporain : dans sa thèse, il s’est intéressé à la question de l’eau à Jérusalem entre la fin du xixe siècle et la mise en place de l’État d’Israël (La Soif de Jérusalem, 1860-1948. Essai d’hydrohistoire, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010). Il a plus récemment publié un autre ouvrage, à nouveau centré sur l’histoire de Jérusalem au début du XXe siècle : Jérusalem 1900. La ville sainte à l’âge des possibles, Paris, Armand Colin, 2013. Il est également directeur du projet européen « Open Jerusalem ».
Vincent Lemire, directeur de cette publication, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée. Ses recherches portent sur Jérusalem et le Proche-Orient contemporain : dans sa thèse, il s’est intéressé à la question de l’eau à Jérusalem entre la fin du xixe siècle et la mise en place de l’État d’Israël (La Soif de Jérusalem, 1860-1948. Essai d’hydrohistoire, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010). Il a plus récemment publié un autre ouvrage, à nouveau centré sur l’histoire de Jérusalem au début du XXe siècle : Jérusalem 1900. La ville sainte à l’âge des possibles, Paris, Armand Colin, 2013. Il est également directeur du projet européen « Open Jerusalem ».
![]() Katell Berthelot, historienne des religions, et plus particulièrement du judaïsme ancien. Avec Dionigi Albera, elle a notamment publié aux éditions Flammarion en 2013 Dieu, une enquête. Judaïsme, christianisme, islam, ce qui les distingue, ce qui les rapproche. Directrice au CNRS, rattachée au Centre Paul-Albert Février, elle a séjourné de 2007 à 2011 au Centre de recherche français de Jérusalem (CRFJ).
Katell Berthelot, historienne des religions, et plus particulièrement du judaïsme ancien. Avec Dionigi Albera, elle a notamment publié aux éditions Flammarion en 2013 Dieu, une enquête. Judaïsme, christianisme, islam, ce qui les distingue, ce qui les rapproche. Directrice au CNRS, rattachée au Centre Paul-Albert Février, elle a séjourné de 2007 à 2011 au Centre de recherche français de Jérusalem (CRFJ).
![]() Julien Loiseau, maître de conférences habilité à diriger des recherches à l’université Paul-Valéry Montpellier-3, et directeur du Centre de recherche français de Jérusalem (CRFJ). Spécialiste de l’Orient médiéval, on lui doit notamment sa très belle monographie sur les Mamelouks (Les Mamelouks. Une expérience politique dans l’Islam médiéval, Paris, Seuil, 2014).
Julien Loiseau, maître de conférences habilité à diriger des recherches à l’université Paul-Valéry Montpellier-3, et directeur du Centre de recherche français de Jérusalem (CRFJ). Spécialiste de l’Orient médiéval, on lui doit notamment sa très belle monographie sur les Mamelouks (Les Mamelouks. Une expérience politique dans l’Islam médiéval, Paris, Seuil, 2014).
![]() Yann Potin, historien et archiviste, chargé d’études documentaires principal aux Archives nationales, maître de conférences associé en histoire du droit à l’Université Paris Nord, membre du comité de pilotage du projet européen « Open Jerusalem ». Tout comme Julien Loiseau, il a participé à la coordination de L’Histoire du monde au XVe siècle, dirigée par Patrick Boucheron et parue chez Fayard en 2009.
Yann Potin, historien et archiviste, chargé d’études documentaires principal aux Archives nationales, maître de conférences associé en histoire du droit à l’Université Paris Nord, membre du comité de pilotage du projet européen « Open Jerusalem ». Tout comme Julien Loiseau, il a participé à la coordination de L’Histoire du monde au XVe siècle, dirigée par Patrick Boucheron et parue chez Fayard en 2009.
Jérusalem, de l’âge du bronze à nos jours : construction d’une « capitale impossible »
Ces quatre auteurs signent ainsi une riche synthèse, qui se lit aisément et retrace toute l’histoire de la ville de Jérusalem, de l’âge du bronze à nos jours. Sept chapitres découpent de manière chronologique un passé plurimillénaire. Loin de vouloir résumer ici le contenu de cet ouvrage aussi dense qu’éclairant, contentons nous d’énumérer les points principaux de ces chapitres, afin de refixer les très grandes lignes de l’histoire de Jérusalem : le premier chapitre se penche sur la période antique de la ville, jusqu’à la provincialisation romaine de la Judée, et y décrit la naissance du judaïsme, première religion à ériger Jérusalem en ville sainte ; le deuxième chapitre revient sur la période tardive et du haut Moyen Âge, en cherchant à montrer les multiples croisements entre la civilisation romaine et les traditions judéo-chrétiennes – croisements qui participent pleinement de l’évolution de la ville ; le troisième chapitre se consacre à la Jérusalem des Omeyyades et des Abbassides, de la conquête arabe au viie siècle à celle des croisés en 1099 – date qui marque le début des longues et âpres luttes pour la ville désormais trois fois saintes : en quelques siècles, Jérusalem passe et repasse aux mains de divers belligérants. Ainsi, le quatrième chapitre est dédié au royaume franc dont Jérusalem fut la capitale de 1099 à 1197 ; mais en 1197, la ville est reprise par Saladin et dirigée par les Ayyoubides puis par les Mamelouks qui parviennent à vaincre les hordes mongoles de Hülegü (petit-fils de Gengis Khan) en 1260 à la bataille de ‘Ayn Jalut, et entrent dans Jérusalem en 1261, inaugurant sept siècles de domination turque à Jérusalem ; cette domination turque, c’est donc d’abord celle des Mamlouks qui succèdent aux Ayyoubides (chapitre 5), puis celle des Ottomans (chapitre 6). Cette longue domination est synonyme de grande stabilité pour la ville. Or, lorsque l’Empire ottoman disparaît au sortir de la Première Guerre mondiale, cette stabilité vole également en éclat ; la Jérusalem du xxe siècle est au contraire marquée par une période de ruptures et de fractures : « L’image qui s’impose est celle d’une ville en guerre, ou plutôt d’une succession de guerres qui chacune réorientent le destin de la Ville sainte ». De la Première Guerre mondiale à l’intifada al-Aqsa (2000-2004), le septième et dernier chapitre montre combien Jérusalem est sans cesse tiraillée entre plusieurs peuples ; il nuance néanmoins cette idée de simple fracture, et insiste sur certaines continuités (notamment un relatif équilibre démographique entre les communautés tout au long du xxe siècle, avec un léger avantage pour la population juive). Au final, quel avenir pour Jérusalem ? Proclamée depuis 1980 capitale éternelle et indivisible de l’Etat d’Israël, Jérusalem a-t-elle trouvé là une conclusion à son histoire plurimillénaire ? Les auteurs insistent plutôt sur le « point de bifurcation » où elle se trouve : sa capitalisation, mal acceptée à l’international, ne saurait cacher que Jérusalem est la moins juive des grandes métropoles d’Israël ; et Jérusalem « demeure plus que jamais une capitale paradoxale, voire une capitale “impossible”, tiraillée par son triple statut de capitale universelle, nationale et binationale » ; d’ailleurs, il est encore aujourd’hui impossible de savoir comment trancher le sort de Jérusalem pour trouver une solution au conflit israélo-palestinien (la question du statut de la ville est tellement problématique et complexe qu’elle n’a pas été intégrée aux négociations de 1993 entre Israéliens et Palestiniens).
Au-delà des communautarismes : circulations, échanges, interactions
La richesse de cette longue histoire de Jérusalem réside également (voire surtout ?) dans sa capacité à mettre en avant les porosités entre les traditions des trois monothéismes : circulations, échanges, transferts et interactions sont à l’honneur dans cette histoire. Par exemple, le chapitre 6 montre combien, en 1908, à Jérusalem, la promulgation de la Constitution par les Jeunes-Turcs donne lieu à des scènes de liesse entre les citoyens de toutes les communautés et confessions, qui fraternisent entre eux ; en effet, cette nouvelle promulgation d’une Constitution d’inspiration libérale (qui avait déjà été promulguée en 1876, mais suspendue presque immédiatement) est accueillie avec joie par les minorités nationales qui espèrent pouvoir vivre une démocratisation de l’Empire ottoman ; or, les auteurs de montrer que « le slogan “liberté, égalité, justice” s’est concrétisé par le libre accès de tous les habitants à l’ensemble des lieux saints de la ville ».
Cette approche permet ainsi de sortir d’une vision d’une Jérusalem qui aurait été, de tout temps, sclérosée par les communautarismes – alors que les conflits et difficultés que connaît aujourd’hui le Proche-Orient se cristallisent justement autour des passions confessionnelles et communautaires, cette volonté de montrer qu’il n’en a pas toujours été ainsi est à saluer : « Cette simple anecdote permet de mesurer combien est singulière l’histoire de Jérusalem dans ces années 1900, combien il est difficile aujourd’hui de se la représenter, mais aussi combien il est nécessaire d’en conserver la trace ».
C’est là l’un des plus grands mérites de cette riche et brillante analyse.
source :


