Antisionisme, antisémitisme et idéologie coloniale

Dans le débat qui agite la France autour de l’antisémitisme, deux dimensions sont souvent absentes : le fait que, durant la première moitié du XXe siècle, la grande majorité des juifs était hostile au sionisme (étaient-ils aussi antisémites ?) ; que la caractéristique principale de ce mouvement était de s’inscrire dans une logique coloniale de conquête et de peuplement.
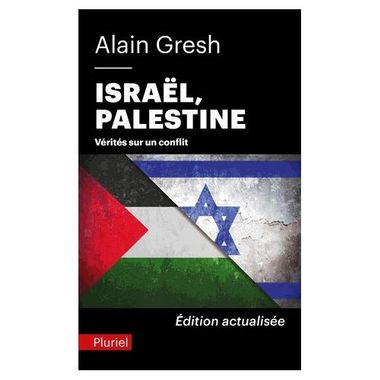
Extraits du livre d’Alain Gresh, Israël-Palestine, vérités sur un conflit (Fayard, 2017).
Le sionisme n’a été que l’une des réponses possibles, longtemps très minoritaire, à la « question juive ». Durant la fin du XIXe siècle et avant la première guerre mondiale, la grande majorité des juifs d’Europe centrale et de Russie « vote avec ses pieds », en émigrant massivement à l’ouest, et notamment aux États-Unis, la Terre promise de tant de laissés-pour-compte… D’autres, nombreux, font le pari de l’intégration. À partir de 1880, et malgré l’antisémitisme, le nombre de mariages mixtes chez les juifs allemands ne cesse d’augmenter : entre 1901 et 1929, la proportion passe de 16,9 à 59 %. En France aussi, cette « assimilation » s’accélère. La participation active des juifs aux mouvements révolutionnaires transnationaux, notamment socialistes et communistes, qui prônent la fraternité universelle, peut être considérée comme une autre de leurs répliques aux discriminations dont ils sont l’objet. Quant aux religieux, ils rejettent pour la plupart le sionisme : l’État juif ne peut renaître et le Temple ne peut être relevé qu’avec la venue du Messie.
Les réticences d’Albert Einstein
Le sionisme n’est pas le seul mouvement organisé spécifique des juifs de l’Est. En 1897 est créé le Bund, l’Union générale des ouvriers juifs de Lituanie, Pologne et Russie. Il concurrencera le sionisme jusque dans les années 1930. Il se veut nationaliste et socialiste, se fonde sur des principes de classe, prône le yiddish comme langue nationale et une autonomie politico-culturelle conforme aux thèses de ceux que l’on appelle les « austro-marxistes ». Les bundistes appellent à l’émancipation « sur place » des masses juives, répétant : « Les palmiers et les vignobles de Palestine me sont étrangers. » Ils prêchent la solidarité des ouvriers juifs avec la classe ouvrière internationale et opposent le patriotisme de la galout (l’« exil ») au patriotisme sioniste. Tombé dans l’oubli, ce mouvement signera des pages glorieuses de l’histoire de l’Europe centrale, notamment par son rôle dans l’insurrection du ghetto de Varsovie en 1943. Il sera finalement écrasé en Pologne par les nazis et en Union soviétique par les communistes, dont les positions sur la « question juive » fluctueront au gré des événements et des retournements de doctrine. Pour concurrencer le sionisme, l’URSS va jusqu’à concevoir une république autonome juive, le Birobidjan, à l’extrémité orientale de la Sibérie.
La création de l’État d’Israël consacre la victoire du mouvement sioniste, victoire qu’ont rendue possible l’antisémitisme hitlérien et le génocide. Cet État regroupe une proportion croissante des juifs du monde – quelle que soit la définition que l’on donne à ce terme –, mais inférieure à 40 %. Des centaines de milliers d’entre eux ont préféré l’intégration, aux États-Unis ou en Europe, même si Israël réussit désormais à en mobiliser une fraction importante en faveur de ses options. Ils se sentent, à juste titre, davantage en sécurité à New York ou à Paris qu’à Tel-Aviv ou à Jérusalem. Faut-il se réjouir du triomphe de ce nationalisme étroit, autour d’un État ? Bien que sioniste, Albert Einstein exprimait ses inquiétudes : « La manière dont je conçois la nature essentielle du judaïsme résiste à l’idée d’un État juif, avec des frontières, une armée et une certaine mesure de pouvoir temporel, quelque modeste qu’il soit. J’ai peur des dégâts internes que cela entraînera sur le judaïsme — et surtout du développement d’un nationalisme étroit dans nos propres rangs […]. Un retour à une nation, au sens politique du terme, équivaudrait à se détourner de la spiritualité de notre communauté, spiritualité à laquelle nous devons le génie de nos prophètes. »
« Le sionisme n’est pas le corollaire obligatoire, fatal, de la persistance d’une identité juive, remarque Maxime Rodinson ; ce n’est qu’une option. » Et cette option est critiquable, non seulement comme toute idéologie nationaliste, mais aussi parce que son aboutissement — la création d’un État juif — n’était possible que par la dépossession des Palestiniens. Le sionisme s’est pleinement inscrit — et ce fut l’une des conditions majeures de sa victoire — dans l’aventure coloniale. Ce fut et cela reste sa principale faute.
Rien de commun avec ce que l’on appelle « l’Orient »
Le dévouement ou l’idéalisme de nombre de militants sionistes n’est pas en cause. Un jeune juif débarqué sur la Terre promise en 1926 pouvait écrire : « Je peux être fier car depuis un an que je suis en Palestine, je me suis débarrassé de la gangue d’impureté de la diaspora et je me suis purifié du mieux possible. Je voulais une patrie. Être un homme comme les autres, égal aux autres, fier comme eux d’être en Palestine. Dès l’instant où mes pieds ont foulé la terre de mes ancêtres, j’ai rompu tout lien avec l’Europe et l’Amérique. » Il changea de nom, se fit appeler Chaïm Shalom et déclara : « Je suis hébreu et mon nom est hébreu car je suis issu du pays des Hébreux. »
En dépit d’un credo socialiste — ou parfois à cause de lui —, les sionistes ressemblaient aux colons installés en Algérie ou en Afrique du Sud, convaincus de faire progresser la civilisation face à des populations sauvages. Le sionisme en Palestine, malgré des formes particulières, se rattache au mouvement de colonisation sur deux plans : par son attitude à l’égard des populations « autochtones » ; par sa dépendance à l’égard d’une métropole, la Grande-Bretagne, au moins jusqu’en 1939. D’ailleurs, à l’époque où le colonialisme n’avait pas la connotation négative qu’il a aujourd’hui, Theodor Herzl écrivait à Cecil Rhodes, l’un des conquérants britanniques de l’Afrique australe : « Mon programme est un programme colonial. » Zeev Jabotinsky, le dirigeant du mouvement sioniste révisionniste, pour sa part, se réjouissait : « Dieu merci, nous juifs n’avons rien en commun avec ce que l’on appelle l’“Orient”. Nous devons venir en aide à ceux parmi le peuple qui sont incultes et qui s’inscrivent dans des traditions et des lois spirituelles archaïques orientales. Nous allons en Palestine d’abord pour notre “bien-être” national, ensuite pour en expurger systématiquement toute trace de l’“âme orientale”. »
Mordechaï Ben Hillel Ha Cohen, un juif installé à Jérusalem, note : « Nous sommes en Palestine la population la plus civilisée, personne ne peut rivaliser avec nous sur le plan culturel. La plupart des indigènes sont des fellahs et des bédouins ignorant tout de la culture occidentale. Du temps sera encore nécessaire avant qu’ils apprennent à vivre sans rapines, vols et autres forfaits, jusqu’à ce qu’ils éprouvent de la honte devant leur nudité et leurs pieds nus et qu’ils adoptent un mode d’existence où prévaudra la propriété privée, et où il sera nécessaire que des routes soient tracées et les chaussées goudronnées, que les écoles, les maisons de charité et les tribunaux essaiment sans qu’il y ait de corruption. » Mais l’insondable « âme orientale » semble résister à des décennies de civilisation puisque Moshé Katsav, alors président d’Israël, déclare en mai 2001 : « Il existe une immense fracture entre nous [les juifs] et nos ennemis, pas seulement en ce qui concerne les capacités, mais aussi sur le plan de la morale, de la culture, du caractère sacré de la vie et de la conscience […]. Ils sont nos voisins ici, mais on a l’impression qu’à une distance de quelques centaines de mètres il y a des gens qui ne sont pas de notre continent, de notre monde, mais qui finalement appartiennent à une autre galaxie. » Sont-ils humains, ces Palestiniens ?
Les Palestiniens comme animaux sauvages
À la suite d’émeutes à Jaffa en 1921, une commission d’enquête britannique note que le mouvement ne constituait nullement un pogrom antisémite, mais que les insurgés haïssaient les sionistes, non les juifs. Le Jewish Chronicle, organe des juifs britanniques, s’insurge : « Essayez d’imaginer que les animaux sauvages du parc zoologique sortent de leur cage et tuent quelques-uns des visiteurs, et que la commission chargée d’enquêter sur les circonstances établisse que la raison du drame est que les animaux n’aimaient pas leurs victimes. Comme s’il ne relevait pas du devoir de la direction du zoo de garder les animaux dans leurs cages et de s’assurer qu’elles soient bien fermées. » Quelle franchise ! Frantz Fanon, psychiatre antillais rallié à la révolution algérienne, auteur d’un pamphlet célèbre, Les Damnés de la terre (1961), constate : « Le langage du colon, quand il parle du colonisé, est un langage zoologique. On fait allusion aux mouvements de reptation du Jaune, aux émanations de la ville indigène, aux hordes, à la puanteur, au pullulement, au grouillement, aux gesticulations. Le colon, quand il veut bien décrire et trouver le mot juste, se réfère constamment au bestiaire. »
La conquête de la terre comme le « refoulement » des autochtones confirment la dimension coloniale du mouvement sioniste. L’un de ses cadres reconnaît dès les années 1910 : « La question arabe s’est révélée dans toute son acuité dès le premier achat de terres, lorsque je dus expulser pour la première fois des habitants arabes pour y installer à la place nos frères. Longtemps après continua de résonner à mes oreilles la triste complainte des bédouins rassemblés cette nuit-là autour de la tente des pourparlers, avant qu’ils ne quittent le village de Shamsin […]. J’avais le cœur serré et je compris alors à quel point le Bédouin était attaché à sa terre. » Mètre carré après mètre carré, les colons juifs s’emparent des terres, repoussant les Arabes.
Aucun compromis n’est possible, Ben Gourion en a bien conscience : « Tout le monde considère les relations entre juifs et Arabes comme problématiques. Mais ils ne voient pas tous que cette question est insoluble. Il n’y a pas de solution ! Un gouffre sépare les deux communautés. […] Nous voulons que la Palestine soit notre nation. Les Arabes veulent exactement la même chose. »
Israël Zangwill, un proche de Theodor Herzl, explique dans la presse britannique durant la Première Guerre mondiale : « Si l’on pouvait exproprier, avec compensation, les 600 000 Arabes de Palestine, ou si l’on pouvait les amener à émigrer en Arabie, car ils se déplacent facilement [sic !],ce serait la solution de la plus grande difficulté du sionisme. » Herzl avoue dans son journal en 1895 : « Nous devons les exproprier gentiment. Le processus d’expropriation et de déplacement des pauvres doit être accompli à la fois secrètement et avec prudence. » Il sera achevé, sur une grande échelle, en 1948-1949.
L’appui indispensable de Londres
Il est vrai que les juifs ne débarquent pas d’une « métropole ». Ils arrivent de différents pays et ne peuvent envisager de « retourner » en Russie ou en Pologne, comme d’ailleurs les Européens blancs, protestants en majorité, installés aux Amériques et qui enferment les Indiens dans des réserves après avoir essayé – et largement réussi – de les exterminer. Mais le mouvement sioniste bénéficie tout de même du soutien de Londres, sans lequel il serait voué à l’échec : ainsi, pour la seule décennie qui suit l’instauration du mandat en 1922, on compte 250 000 immigrés, plus du double par rapport à la décennie précédente. « Pendant tout mon service en Palestine, écrit Arthur Wauchope, le haut-commissaire britannique qui sévit à Jérusalem à partir de 1931, je considérais de mon devoir d’encourager le peuplement juif et je n’avais d’autre ambition que de voir sa sécurité assurée. » Il évoque d’ailleurs la « grande aventure » de la colonisation. Ni l’émigration, ni l’achat de terres, ni la création de structures étatiques n’auraient été possibles sans le parapluie britannique. Bien sûr, il pouvait surgir des contradictions entre les intérêts du yishouv (la communauté juive de Palestine) et ceux de Londres, mais, au moins jusqu’en 1939, elles furent secondaires.
Cette alliance est servie par ce que j’appellerais les « affinités culturelles ». Je prends un exemple. À la suite des violentes émeutes qui éclatent en Palestine en 1929, de nombreux responsables britanniques, sur place ou en Grande-Bretagne, sont convaincus de la nécessité d’un changement de cap passant par la restriction de l’immigration et de l’achat de terres. Le ministère des colonies prépare en octobre 1930 un Livre blanc reprenant ces propositions. Mais Weizmann fait jouer toutes ses relations, Ben Gourion consulte le chef du gouvernement britannique et obtient une garantie de la liberté d’immigration et d’achat de terres, qualifiée de « lettre noire » par les Arabes. Le premier ministre britannique discute même avec le numéro un sioniste le moyen de privilégier les juifs dans les arrangements, au détriment du principe de la parité (traitement égalitaire des juifs et des Arabes) affirmé publiquement.
Cet éclatant succès, le mouvement le doit à son entregent, à ses contacts politiques, à sa connaissance du système politique britannique. Les sionistes ont plus de chances de se faire entendre que les représentants arabes ou palestiniens, dont la culture, les traditions, le mode même de négociation sont étrangers aux Européens. Les sionistes sont des Occidentaux qui parlent à des Occidentaux. Cet atout, ils en useront à chaque étape du conflit. Israël, pour reprendre l’expression de Maxime Rodinson, est un « fait colonial ». Comme l’Australie ou les États-Unis, le pays est né d’une conquête, de l’expropriation des autochtones. En revanche il n’est pas, contrairement à l’Afrique du Sud de l’apartheid, une « société coloniale », une société qui a besoin des « indigènes » pour survivre.
D’autre part, même s’il a été bâti sur une injustice, Israël est désormais un État reconnu par la communauté internationale, par les Nations unies. Penser, comme l’ont fait et continuent de le faire certains, que l’on peut « expulser » les Israéliens, les renvoyer « chez eux », n’est ni moralement défendable ni politiquement réaliste. Une injustice ne peut être réparée par une autre injustice. Vivent désormais en Terre sainte deux peuples, l’un israélien, l’autre palestinien. On peut rêver, comme le font quelques intellectuels palestiniens et israéliens, qu’un seul État pourrait les regrouper ; c’est une belle utopie, que notre génération ne verra pas se réaliser. Et, quoi qu’il en soit, aucune solution ne pourra être imposée de façon unilatérale aux Palestiniens ni aux Israéliens.
Alain Gresh
Spécialiste du Proche-Orient, il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont De quoi la Palestine est-elle le nom ? (Les Liens qui libèrent, 2010) et Un chant d’amour. Israël-Palestine, une histoire française, avec Hélène Aldeguer (La Découverte, 2017).
Source : Orient XXI
